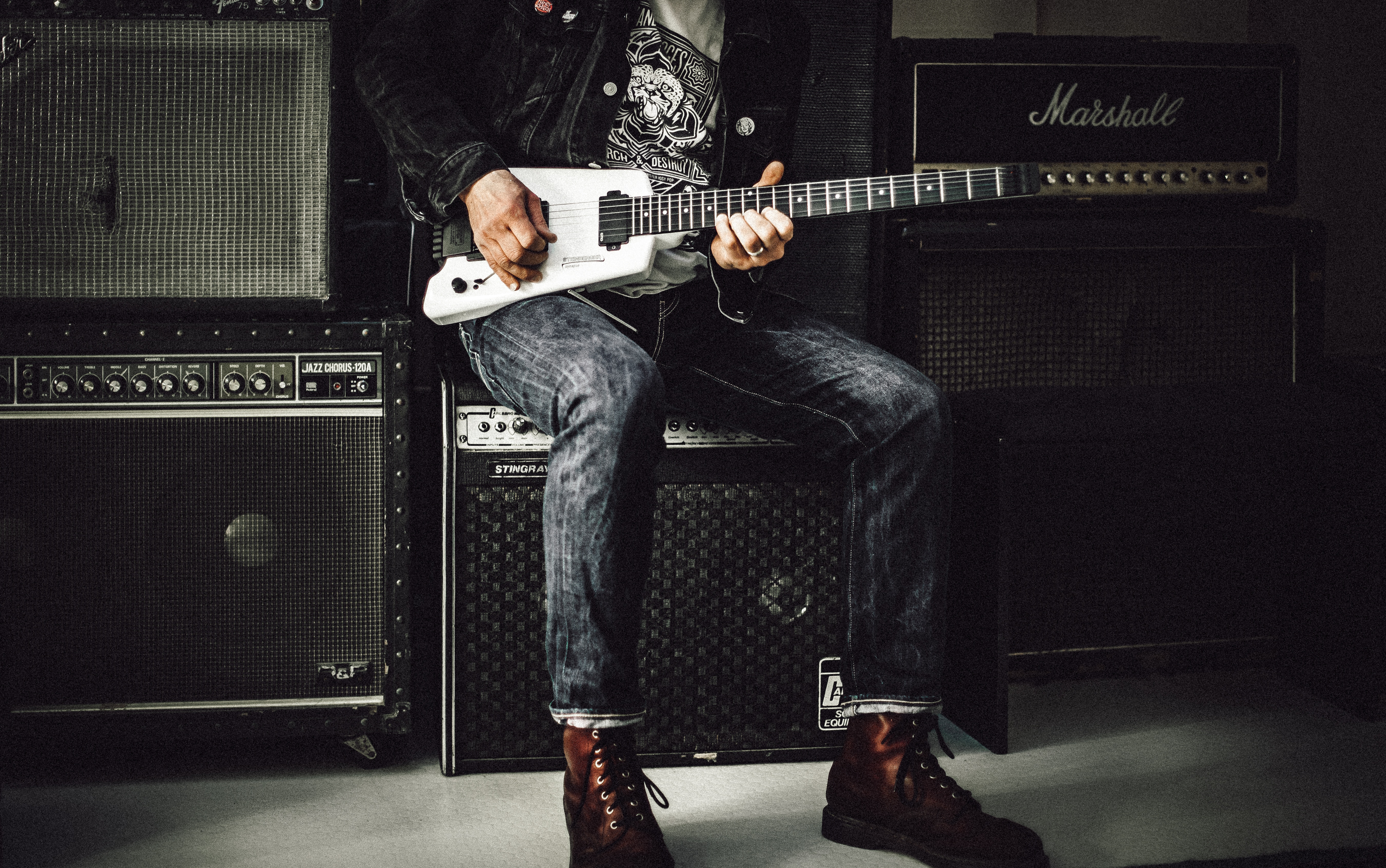Une sombre affaire de succession
Ces derniers mois, la presse à scandale s’est transformée en ogresse, mangeant du pain béni sur le malheur des autres, les pauvres «people».
Chaque jour, nous parvient un lot d’informations partielles et consciemment épurées portant sur une sombre affaire de succession et de pseudos droits moraux d’une famille qui se déchire suite au décès d’un homme, depuis longtemps icône d’une nation.
Dernières volontés, exhérédation (action de déshériter), trust et autres structures offshore dont une «mamie de paille» serait la dirigeante, actions en justice, tout y est. Une saga comme on les aime : gorgée de rebondissements en matière de non-sens et qui nous agacent peu à peu…
Cela étant, le fond du sujet est intéressant.
Quid des droits de propriété intellectuelle en cas de succession ?
Qu’est-ce qu’un droit d’auteur ? Quelle protection confère-t-il ? Et à qui ?
Un droit d’auteur (ou droit voisin dans le « jargon ») est un droit immatériel en ce sens qu’il confère un statut juridique à une création de l’esprit, une « œuvre » qui se doit de revêtir un caractère original, telle par exemple la prestation d’un auteur, d’un compositeur et/ou d’un artiste-interprète.
Toute personne qui participe à la création d’une œuvre « originale » (nouvelle) peut ainsi prétendre à la qualité d’auteur. L’auteur a ainsi un droit exclusif sur son œuvre et de décider SI, QUAND et COMMENT, son œuvre sera diffusée (divulguée) au public, à quel moment et via quel support ou moyen de diffusion.
Un corpus législatif impressionnant confère une protection toute particulière au droit d’auteur.
Deux types de catégories de droits sont conférés par un droit d’auteur : des droits moraux et des droits patrimoniaux.
Ces derniers ont pour vocation d’être sujets à rémunération et sont transmissibles par succession.
Les droits moraux quant à eux, ont un lien particulier qui unit l’auteur à son « œuvre » et sont plus complexes.
Ils comprennent en particulier le droit à la paternité et le droit à l’intégrité de l’œuvre.
Les droits moraux entrent dans la catégorie des droits de la personnalité au sens des articles 28 et ss CCS. En principe, ils sont en incessibles. Mais qui dit règle dit exception(s)….
Ainsi, l’auteur peut autoriser, à défaut de céder ses droits moraux, l’exercice des prérogatives qui en découlent, par exemple le droit de s’opposer à tout usage illicite de l’œuvre ou qui dénaturerait l’œuvre de son contenu original ou porterait atteinte à la réputation de son auteur.
Qu’est-ce qui peut motiver un droit de regard ?
Un droit de regard a pour vocation d’anticiper toute atteinte à la personnalité du défunt.
Dans notre sombre affaire, il semblerait donc que certains protagonistes craignent que l’album posthume de leur père soit utilisé pour une pub de dentifrice ou qu’il soit destiné à être «masterisé» en danse des canards par une belle-mère acariâtre ? Soyons sérieux que Diable !
Existerait-t-il un soupçon fondé laissant croire que cette dernière puisse immédiatement modifier, mutiler l’œuvre posthume d’un homme qui fût son compagnon depuis plus de 20 ans, père de ses enfants et qu’elle a probablement aimé jusqu’à ce qu’il rende son dernier souffle de voix? Et ceci de manière telle à ce que cette potentielle « injure » porte gravement atteinte à l’honneur ou à la réputation de son défunt mari?
Alors, quel pourrait être le but ultime de cette « manœuvre » judiciaire ?
Les droits dérivés seraient-ils au cœur du problème ?
Les droits dérivés découlent et s’inspirent de l’œuvre initiale. Ils sont définis comme une création de l’esprit conçue à partir d’une oeuvre préexistante.
Pour exister et être reconnus en tant qu’œuvre à part entière et générer des droits patrimoniaux, les auteurs de tels droits (adaptation cinématographique, roman, etc…) devront obtenir l’aval de l’auteur de l’œuvre originelle.
Si celui-ci est décédé, ce droit passera aux ayants-droits désigné par l’auteur de ladite oeuvre initiale.
Ainsi, accorder un droit dérivé peut donc avoir des conséquences financières conséquentes, raison pour laquelle le consentement du titulaire des droits sera requis.
Or, dans notre saga familiale, il semblerait qu’obtenir « l’adoubement » d’une belle-mère et/ou de demi-sœurs soit un geste/acte, auquel les héritiers « déshérités » refusent de se soumettre.
Leur fierté parle mais leur porte-monnaie aussi.
Alors Ego ? Argent ? Les Deux ?
Un juriste digne de soi dirait : « Cela dépend, les deux à la fois ».
Un stratège peu scrupuleux vous dirait : « Peu importe les moyens, seuls les résultats comptes ».
Tout orateur insensible vous dirait : « Depuis quand le talent est-il héréditaire? », question à laquelle je répondrais « Depuis que le droit de la propriété intellectuelle existe », soit en Europe dès 1952 avec l’adoption de la Convention universelle sur les droits d’auteurs conclue à Genève.
Finalement, une seule chose est sûre : même si la saga peut avoir autant de succès que « Les Feux de l’Amour », les seuls qui porteront atteinte au droit moral du défunt rocker seront justement ceux qui sont aujourd’hui à l’origine de ces actions judiciaires, trop souvent dilatoires.
L’ironie du sort voudra que c’est ensemble, cette fois-ci, qu’ils y réussiront !
Dommage pour eux.
Tant mieux pour la presse people.
© Lex Invest, April 2018